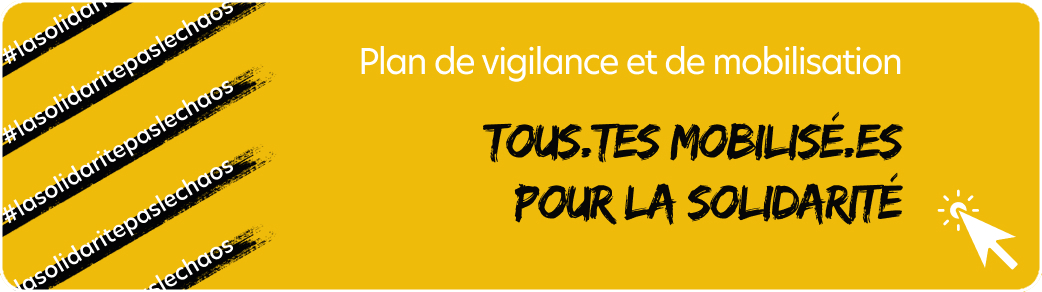18 avril 2025
20 février 2025
Expérimentation DEFI-TR : faire de l’écologie l’affaire de toutes et tous !
Le 13 janvier dernier, la FAS organisait une première Rencontre dans le cadre de la Chaire Transition écologique et évolution du travail social lancée avec le soutien de la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Cette Rencontre a été l’occasion de présenter les réalisations à mi-parcours d’une expérimentation menée avec le département de Seine-Saint-Denis, le Campus de la Transition et l’association VoisinMalin, dans deux agences locales d’insertion. L’objectif de l’expérimentation DEFI-TR ?
Aider les professionnel·le·s des agences à intégrer la question écologique à leur activité, en partant des préoccupations et des savoirs des personnes qu’ils et elles accompagnent, et des ressources du territoire.
En invitant la sociologue Elisabetta Bucolo à rebondir à partir de ses propres travaux, la FAS a souhaité ouvrir un espace de dialogue durable sur ces sujets.
Nathalie Latour, directrice générale de la FAS, a introduit la rencontre en rappelant que l’enjeu de transition écologique et de justice sociale s’était imposé comme une thématique forte depuis 2022 et avait été intégré dans les axes stratégiques du projet fédéral 2022-2027. Au sein du réseau, la mobilisation a commencé autour de questions relevant de la responsabilité sociétale des organisations (RSO), par exemple autour du bâti et de la consommation énergétique. Les activités portées par des structures d’insertion par l’activité économique (maraîchage, ressourceries, etc.) sont aussi un élément de réponse important aux enjeux de transition écologique.
« L’objectif, désormais, est d’aller au-delà d’éléments de réponse isolés ; il faut analyser ce que la transition écologique fait structurellement au secteur de la solidarité, comment le travail social va en être impacté, et le rôle que nous pouvons jouer pour plus de justice sociale. »
Nathalie Latour, directrice générale de la FAS

Dans cette perspective, la FAS a décidé de recruter la sociologue Maÿlis Dupont, afin de structurer et d’animer une activité de recherche autour de ces enjeux, en lien avec l’ensemble du secteur. La Chaire « Transition écologique et évolution du travail social » qu’elle anime bénéficie du soutien de la Délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté (DIPLP).
Il s’agit de comprendre ce que la transition écologique fait aujourd’hui et fera demain aux métiers de l’intervention sociale : qu’est-ce qui interdit ou permet que les intervenant⸱es sociaux⸱ales jouent pleinement leur rôle d’inclusion et de lutte contre les inégalités, y compris environnementales, à l’heure du Nouveau régime Climatique ? Quelle prise en compte structurelle (et non anecdotique) des préoccupations et des ressources de transition écologique des personnes concernées ? Quelle place fait-on à leurs savoirs, à leurs représentations, à leurs pratiques ?
Au Québec, au Royaume-Uni ou ailleurs, ces questions rassemblent déjà des communautés de professionnel·le·s et chercheur·euse·s, autour de ce que certain·es nomment « travail social vert ». En France, ces enjeux ont bien été identifiés, dans le Livre blanc du travail social (2023) notamment. Mais il faut favoriser les liens et la circulation des savoirs académiques, professionnels, expérientiels, entre tous les acteur·ice·s.
« Nous devons éclairer le rôle que peuvent et doivent jouer les acteurs de la solidarité pour une transition juste. »
Ari Brodach, directeur de la Délégation à la transition écologique et à la résilience du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Le département de la Seine-Saint-Denis soutient cette dynamique, en finançant un grand nombre de projets depuis 2024, au croisement des enjeux d’insertion et de transition écologique. Au nombre de ces projets, l’expérimentation DEFI-TR est déployée par le Campus de la transition, l’association VoisinMalin et la FAS, dans deux premières agences locales d’insertion (ALI) du département. A partir de l’automne, le dispositif devrait être proposé à l’ensemble des ALI volontaires.
« Il s’agit d’apprendre à amener les questions « écologiques » dans des espaces où l’on n’en parle pas, alors que ce sont des questions qui évidemment concernent tout le monde et peuvent avoir un grand impact sur la vie des personnes. Mais les professionnel·le·s ne sont pas vraiment équipé·es pour cela : ils ne se sentent pas capables ou pas légitimes pour en parler, et ils ne font pas forcément le lien à leur métier d’accompagnement »,
Maÿlis Dupont, sociologue et responsable de la chaire Transition écologique et évolution du travail de la FAS

Objectifs, réalisations, difficultés et principaux apprentissages à mi-parcours
Evolution du marché du travail, formations aux métiers verts, connaissance des acteur·ice·s et lieux ressources de son territoire, alimentation et santé, bien-être, etc. : il y a pourtant de nombreuses façons d’entrer dans le sujet, en partant de ce qui fait sens pour les personnes accompagnées au sein des ALI.
Pour diminuer un peu la barrière de la langue (d’autant plus forte sur ces sujets que l’écologie est souvent associée à des termes très techniques) et pour favoriser des postures actives (partage d’expériences, organisation d’une visite ou action, etc.), l’équipe s’appuie sur divers outils et types d’intervention : dans et hors les murs, à partir d’un photolangage, d’une carte, etc., et en proposant des carnets d’enquête qui permettent de garder traces de ce que l’on découvre et partage collectivement en ateliers.
Les expériences des personnes sont diverses, certaines sont arrivées en France récemment et font référence à des pratiques et savoirs évidents dans leurs pays d’origine ; d’autres connaissent le quartier depuis longtemps et ont vu son évolution, la disparition d’espaces verts notamment.
« Le plus difficile, c’est de ne pas avoir d’a-priori. Cela nécessite un effort pour se déconstruire soi-même. Il faut faire d’un sujet intellectuel quelque chose de concret, commencer par de petites actions. C’est comme planter des petites graines. Le premier enjeu, c’est de donner confiance aux personnes et de partir de leurs besoins : bien manger, être en bonne santé, assurer l’avenir de leurs enfants. Et puis la clé, c’est de s’adapter, pour permettre aux allocataires de créer leur propre projet. Bien sûr, il faut lever les freins sociaux, économiques, mais aussi retrouver sa place de citoyen, participer à la vie de la cité. Monter un projet à plusieurs, comme l’organisation d’une visite à La Ferme du cœur, c’est une proposition à laquelle sont rarement confrontés les allocataires. Et ça fonctionne ! Les personnes qui ont fait la visite ont été impressionnées. Une des personnes s’y est engagée bénévolement ensuite. »
Violette Debarbouille, directrice de l’ALI de Drancy
« En tant que demandeur d’emploi, on n’a pas beaucoup d’occasions de faire autre chose que de chercher un boulot, des occasions de prendre l’air. J’ai fait la visite de la Ferme du cœur et la visite du Campus de la transition. C’est un bon souvenir, ça nous aide à nous relâcher, à nous détendre. Ça m’a fait du bien. Quand on ne travaille pas, on est plutôt fermé, on n’a pas envie de bouger. Ça fait du bien de sortir, d’être en groupe, de discuter, au lieu d’être plongé dans les recherches, les déceptions, l’attente qu’on vous rappelle… et de ne pas être rappelé. »
Une personne accompagnée sur l’ALI de Drancy
Charline Le Pense, conseillère de l’ALI de Clichy-sous-bois accompagne un petit groupe d’allocataires qui souhaite monter une visite à la centrale géothermique de Clichy-sous-Bois. Selon elle l’initiative montée par les personnes montent devrait être mieux valorisée.
« C’était pas facile de trouver le bon interlocuteur pour trouver les informations et ensuite coordonner l’action avec des personnes qui n’avaient pas forcément les ressources matérielles et linguistiques nécessaires. Je suis tombée sur des interlocuteurs qui voulaient que ce soit moi leur interlocutrice et pas les personnes accompagnées »
Charline Le Pense, conseillère de l’ALI de Clichy-sous-bois
A mi-parcours de l’expérimentation DEFI-TR, l’équipe-projet témoigne aussi d’un certain nombre de difficultés, que la temporalité du projet aide cependant à atténuer au fur et à mesure : comment faire venir des personnes qui ne se sentent d’abord pas du tout concernées ? comment s’émanciper de représentations et de discours très moralisants sur le sujet (que les personnes elles-mêmes ont la plupart du temps intégrés) ? quel vocabulaire employé pour que chacun·e se sente légitime à participer ? quelles ressources pour les professionnel·es, adaptées à leur territoire et aux problématiques qu’ils et elles rencontrent, pour que leur mobilisation tienne dans la durée ?
« Qui on est pour dire que tel métier n’est pas écolo quand les gens vous disent qu’ils veulent être chauffeur VTC ? »
Un membre de l’équipe-projet

La sociologue Elisabetta Bucolo (CNAM/Lise – CNRS)
Co-construire les savoirs écologiques avec toutes et tous : quels apprentissages de terrain ?
La sociologue Elisabetta Bucolo (CNAM/Lise – CNRS) rebondit sur les difficultés et apprentissages présentés par les partenaires de l’expérimentation DEFI-TR, en présentant ses propres éléments de terrain. L’expérimentation DEFI-TR met en évidence l’importance des questions d’injustice sociale et écologique et l’urgence d’inclure les personnes concernées par des actions ancrées sur un territoire, dans leurs pratiques quotidiennes.
Cependant, la sociologue fait le constat que certains stéréotypes ont la vie dure : l’idée par exemple que les personnes en situation de précarité ne s’intéressent pas ou n’auraient pas l’énergie de s’investir sur les sujets de transition écologique car elles doivent d’abord résoudre des problèmes de survie économique.
Dans le cadre de ses travaux, notamment aux côtés d’ATD-Quart Monde depuis 3 ans, Elisabetta Bucolo montre les différentes formes d’injustices qui opèrent jusque dans la production des savoirs écologiques : quels savoirs sont considérés ? quels témoignages sont audibles ? en quels termes se font les débats ?
Lutter contre les injustices d’ordre socio-environnemental passe aussi par la mise en place de dispositifs, ou de lieux dédiés dans lesquels les savoirs écologiques peuvent être co-produits. Il s’agit d’apprendre à prendre en compte les savoirs des personnes exclues, invisibilisées sur ces sujets.