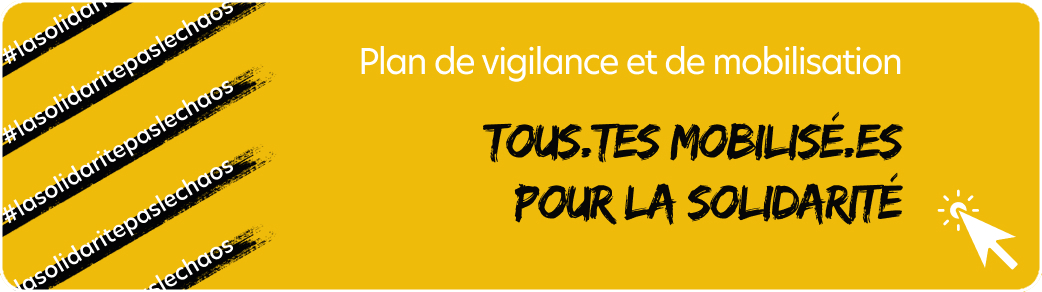À l’approche du Printemps de la participation (programme et inscriptions ici), nous vous proposons une série d’entretiens pour découvrir celles et ceux qui s’investissent chaque jour pour faire vivre et développer les pratiques participatives !
Conseil de vie social, Conseil Régional des PersonnesAccueillies/Accompagnées (CRPA), commission DALO et Logement D’abord, travailleur pair… les expériences passées et présentes de Samir Elhamdi illustrent les nombreuses formes que peut prendre la participation des personnes concernées.
- Qu’est-ce qui vous a poussé à vous investir dans des instances participatives ?
Ça s’est fait naturellement. Mon parcours de vie a toujours été lié au monde associatif. Quand j’étais jeune par exemple, je faisais partie du comité de mon club de basket dans lequel je m’engageais pour que le prix de la licence baisse pour permettre aux jeunes les plus défavorisés de le rejoindre. C’est de là que l’appétence pour le social m’est venu. Mais c’est en 2018 que j’ai vraiment découvert la participation. J’étais alors hébergé dans le « Bon Foyer » à Mulhouse dans lequel je suis devenu président de conseil de vie social (CVS) jusqu’en 2019. Les CVS sont destinés à sensibiliser les personnes accueillies sur le rôle qu’elles ont a joué au sein du foyer dans lequel elles résident. Ça passe par des temps d’échanges entre personnes qui vivent dans le foyer et professionnels. Le président du CVS fait alors remonter jusqu’au chef de service qui devra en faire part à sa hiérarchie, tout ça dans le but de faire évoluer les pratiques au sein de l’établissement. J’ai ensuite été élu en 2019 comme délégué du CRPA de la région Grand Est. En parallèle, j’ai intégré cette année la formation professionnalisante des travailleurs pairs de l’IRTS de Dijon.
- Avez-vous des exemples de ce qu’apporte l’approche participative ?
Lorsque j’étais président du CVS du Bon Foyer à Mulhouse, on a fait remonter aux chefs de services le besoin pour certaines personnes accueillies de bénéficier d’un accompagnement spécifique. Ils nous ont écouté et il y a eu des résultats, c’est ce qui m’a encouragé à continuer sur cette voie et devenir délégué CRPA. En tant que délégué CRPA, je participe maintenant à des commissions comme la commission DALO (Droit au Logement Opposable) dans laquelle sont traités des recours déposés par des personnes en situation d’expulsion dans l’espoir qu’elles puissent être relogées dans de bonnes conditions. La première session à laquelle j’ai participé, j’ai trouvé ça déshumanisant. On a eu 36 dossiers à traiter en une heure et demi, c’était aberrant ! Derrière ces dossiers, il y a des familles, des enfants. Peut-être que parfois les parents ne sont pas de bonne foi, c’est possible, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut pénaliser des enfants qui n’ont rien demandé. S’ils se font expulser, ils vont devoir déménager et l’enfant devra changer d’école et se faire de nouveaux amis, et pour un enfant c’est extrêmement déstabilisant. J’avais l’impression que pendant ces réunions ils n’en prenaient pas compte. Depuis ça a changé et aujourd’hui, j’ai le sentiment qu’ils prennent plus en considération l’impact sur les enfants.
- Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu’est un travailleur pair ?
Le rôle d’un travailleur pair, c’est d’accompagner une personne vers son rétablissement au côté des professionnels qui la suivent. Comme le travailleur pair a vécu des expériences similaires, il est source d’espoir pour la personne qu’il accompagne. Il a su cheminer intérieurement pour identifier la situation dans laquelle il s’est retrouvé, comment et pourquoi il s’y est mis, et qu’est-ce qui existe comme leviers pour s’en sortir. C’est pour ça que notre participation est très importante car elle remobilise des personnes qui n’avaient plus de motivation. On est là pour l’aider à faire son introspection pour qu’elle puisse prendre conscience du cheminement à faire pour se rétablir.
J’aimerais beaucoup que mon intervention au Printemps de la participation fasse prendre conscience que les pairs-aidants font partie intégrante du travail social. Certains travailleurs sociaux voient le travail pair comme une substitution à leur travail alors que nous sommes complémentaires. Nous n’avons pas la même temporalité que les éducateurs spécialisés qui eux ont un temps bien défini pour chaque suivi, et ce temps met la pression aussi bien à l’éducateur qu’à la personne accompagnée. La temporalité du travailleur pair, c’est celle de la personne qu’il accompagne. C’est cette réalisation que je souhaiterais porter pendant cette intervention.
- Quelles sont les avancées nécessaires pour faire progresser la participation ?
Il faut la valoriser. On est de plus en plus solliciter, mais toujours à titre bénévole, alors que notre apport est aussi important que d’autres qui sont rémunérés. Et même parfois, notre temps est utilisé juste pour faire bonne figure, et on doit seulement faire acte de présence pour que ceux qui sont en charge disent qu’on a été intégré dans le processus. Si on veut que l’accompagnement des personnes s’améliore, la valorisation de la participation est l’enjeu numéro 1 à souligner en rouge !
Pour retrouver Samir Elhamdi au Printemps de la participation, inscrivez-vous ici
Pour le programme complet de l’événement, c’est là